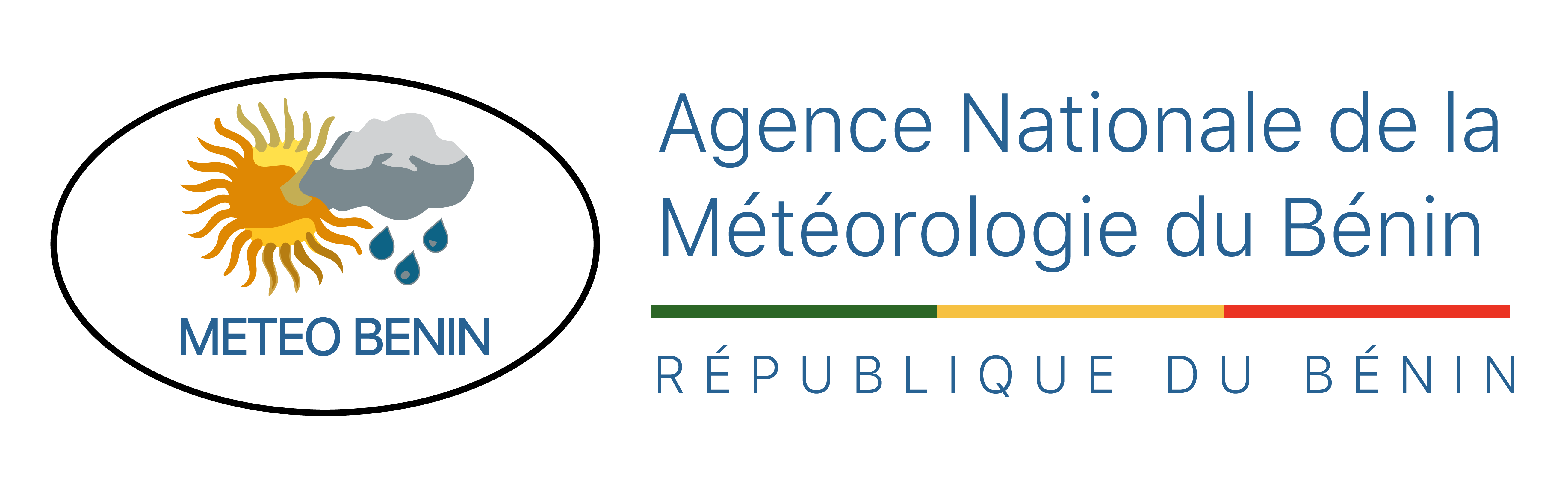I. Synthèses des prévisions
Les prévisions saisonnières sont basées sur l’analyse de la situation actuelle, des évolutions probables des Températures de Surfaces des Océans (TSO), des modèles statistiques issus des données de METEO-BENIN, des connaissances des experts sur les caractéristiques du climat dans la région et des prévisions des centres mondiaux. Le consensus issu de cette analyse a permis d’établir les prévisions ci-après, par rapport à la valeur moyenne de chaque paramètre sur la référence climatologique de 1991–2020.
- Des quantités de pluies moyennes à excédentaires dans les localités du centre et du nord et déficitaires sur la bande côtière sont attendues sur la période Septembre-Octobre-Novembre.
- Des dates de début de saison tardives à moyenne au Sud et précoces à moyennes au Centre sont attendues,
- Des dates de fin de saison tardives à moyennes sont attendues,
- Des durées de séquences sèches courtes à moyenne sont attendues en début et moyennes à longue en fin de saison.
II.Recommandations
A l’endroit des agriculteurs
Au regard des résultats obtenus, il s’avère nécessaire de :
➢prévoir des mécanismes pour résorber les déficits de production envisageables dans les zones exposées aux séquences sèches à travers la promotion du maraichage, de l’agroforesterie et d’activités génératrices de revenus; privilégier les espèces et variétés résistantes au stress hydrique dans les localités où les séquences sèches seront probablement longues vers la fin de saison;
➢Utiliser des calendriers prévisionnels des dates de semis appropriés ;
➢Vu la longueur de la petite saison des pluies, l'usage des variétés exigeant beaucoup d'eau est proscrit ;
➢Interagir avec les techniciens de la météorologie nationale et des services d'agriculture pour des conseils sur les variétés à utiliser et les dates de semis optimales, afin d’éviter la mortalité des jeunes pousses et les pertes (en semences et en main d’œuvre) liées aux séquences sèches au démarrage de la saison ;
➢Modérer l’apport du fertilisant, notamment azotés, pendant la phase d’installation des cultures et les périodes à risques de sécheresse,
➢Encourager la pisciculture ;
➢Assurer un usage efficient des ressources en eau ;
➢Ne pas baisser la garde vis-à-vis d’éventuelles fortes pluies pour minimiser les dégâts sur les hommes, les animaux et les biens matériels.
Pour les autorités nationales, locales et les acteurs au développement (ONGs et OPs)
➢Prendre les dispositions pour mettre en place les intrants agricoles (semences améliorées, engrais et équipements) de bonne qualité, en quantité suffisante et au temps convenable dans les différentes zones ;
➢Appuyer et favoriser la communication de la prévision saisonnière aux producteurs agricoles et aux autres utilisateurs ;
➢Face au risque de sécheresse
Les déficits hydriques qui seraient liés aux cumuls pluviométriques inférieurs à la normale (1991-2020) attendus sur la période Septembre-Octobre-Novembre 2024 dans certaines localités, pourraient affecter la croissance des cultures et favoriser le développement d’insectes ravageurs.
Face à cette situation, il est recommandé de :
- adopter des techniques culturales de conservation de l’eau du sol ;
- privilégier les espèces et variétés résistantes au déficit hydrique et assurer une gestion rationnelle de la ressource en eau pour les cultures et les autres usages;
- renforcer la vigilance contre les ravageurs des cultures (chenille légionnaire et autres insectes nuisibles) ;
- veiller à la gestion rationnelle des ressources en eau pour satisfaire les besoins des barrages hydro-électriques et d’autres aménagements hydro-agricoles importants ;
- veiller à une gestion intégrée des ressources en eau pour une meilleure prise en compte des différents usages et des différentes ressources dans les bassins ;
- interagir avec les techniciens de la Météorologie Nationale, de l'Agriculture et de l’Hydrologie pour des informations et conseils agro-hydro-météorologiques sur les conduites à tenir.
Face au risque d’inondation, il est conseillé de :
- Renforcer la communication des prévisions saisonnières et la sensibilisation des communautés vulnérables, en impliquant entre autres les différentes plateformes de réduction des risques de catastrophe dans la chaine de communication et de gestion des crises ;
- interdire l’occupation anarchique des zones inondables et les bergs lagunaires en particulier dans les agglomérations urbaines ;
- renforcer la veille et les capacités d’intervention des agences en charge du suivi des
inondations, de la réduction des risques de catastrophes et des aides humanitaires ;
- prévoir la disponibilité des stocks en médicaments dans les zones difficiles d’accès suite aux inondations ;
- assurer le curage régulier des caniveaux d’assainissement ;
- faire des exercices de simulation dans le cadre de la préparation des plans de réponses aux inondations.
Face au risque de maladies
Pour réduire le risque de maladies liées à l’eau (Choléra, malaria, dengue, bilharziose, diarrhée, etc.) dans les zones humides ou inondées, il est fortement recommandé de :
- sensibiliser sur les maladies climato-sensibles, en collaboration avec les services de
Météorologie et de la santé,
- encourager l’utilisation de la moustiquaire et mettre en place des stocks d’antipaludéens,
- suivre la qualité de l’eau et mettre en place des produits de traitement.
Protection civile
➢Prendre les dispositions utiles pour éviter ou réduire les dégâts et les pertes liées aux éventuelles inondations dans les zones à risques ;
➢Renforcer les capacités d’intervention des services techniques et éviter de baisser la garde par rapport au suivi du risque d’inondation dans les zones vulnérables.